La moralisation de la vie publique est devenue un objectif incontournable pour tous les acteurs publics, et un refrain omniprésent dans la presse, dans le langage politique et au sein des tribunaux.
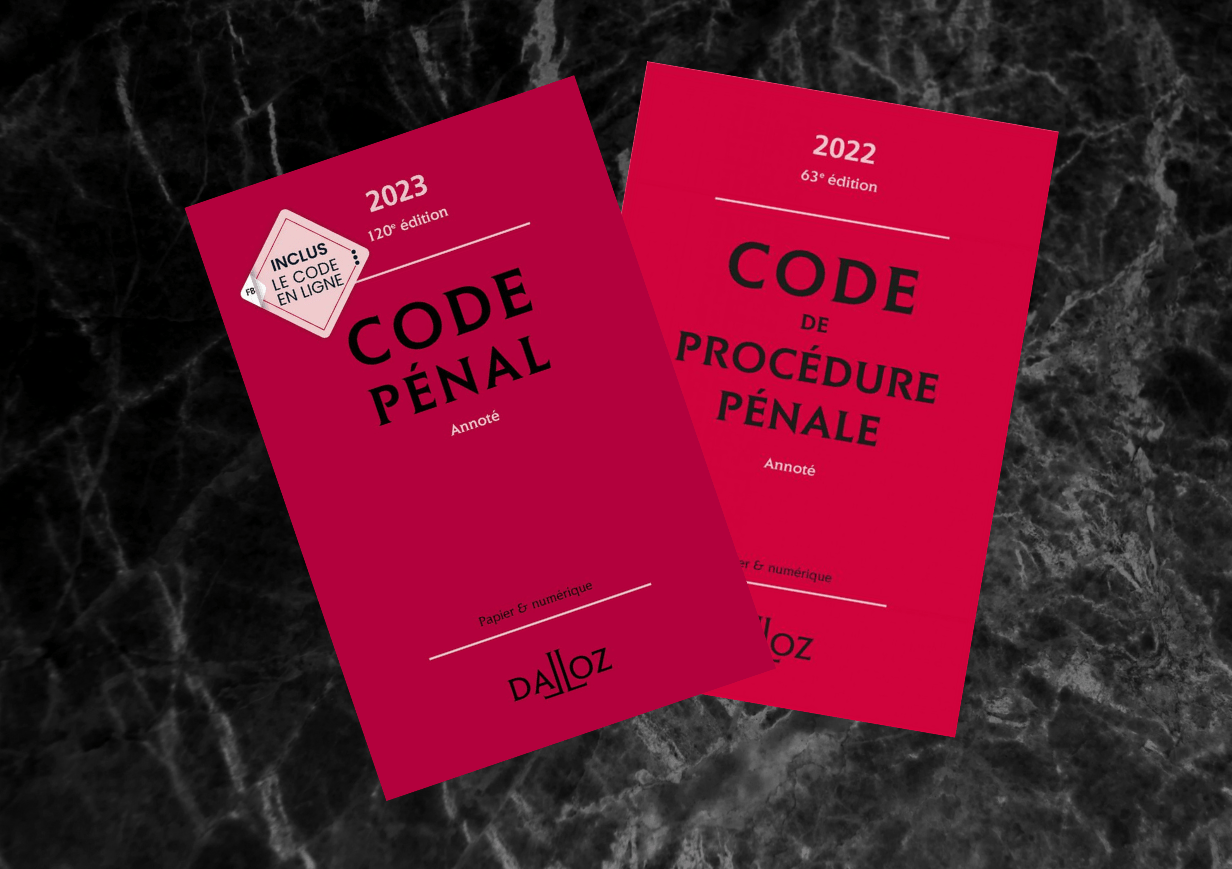
De certains manquements au devoir de probité : la morale érigée en obligation
Servir la chose publique serait une mission presque sacrée, une vocation réservée à ceux qui sont suffisamment probes, presque saints,pour ne pas abuser du pouvoir qui leur est confié, au risque de provoquer la défiance et le désintérêt du peuple pour ses gouvernants, voire le despotisme et la corruption généralisée.
Cette préoccupation des pouvoirs publics pour la droiture de ses représentants, du plus grand au plus petit, ne date pas d’hier, car il semblerait, hélas ! que les hommes soient naturellement enclins à abuser de leur pouvoir, aussi limité soit-il[1].
Les effets néfastes des abus de pouvoir ont conduit les législateurs à ériger en infractions pénales des agissements contraires à la morale publique et attentatoires à la crédibilité, et donc à l’autorité, du gouvernant[2]. Il faut bien, en effet, que « par la disposition des choses, le pouvoir arrête le pouvoir »[3].
Mais cette préoccupation semble, aujourd’hui plus que jamais, sur le devant de la scène, y compris judiciaire.
L’affaire dite « des écoutes téléphoniques » ayant donné lieu au renvoi de Nicolas Sarkozy devant le tribunal correctionnel ou la retentissante affaire de corruption ayant éclaté au sein du Parlement européen en décembre 2022 illustrent cette bataille que livrent, de longue date, les autorités judiciaires contre ce qui pourrait dévoyer les institutions publiques et la confiance qu’elles sont censées susciter.
C’est l’occasion de présenter les grandes lignes de quelques-unes de ces infractions de la vie des affaires publiques, dont les noms sont devenus presque familiers, mais qui restent délicates à distinguer : la corruption (I), le trafic d’influence (II), la prise illégale d’intérêts (III), le favoritisme (IV).
Toutes font partie d’une section du code pénal dont l’intitulé révèle bien la nature de ces infractions : « Des manquements au devoir de probité ».
A titre liminaire : sur les auteurs de ces infractions
Toutes ces infractions ont un dénominateur commun : elles incriminent des actes commis « par une personne dépositaire de l’autorité publique, chargée d’une mission de service public, ou investie d’un mandat électif public », c’est-à-dire, pour schématiser, par les serviteurs de l’Etat[4].
Cette formulation permet d’englober largement les personnes visées, qui peuvent être d’anciens présidents de la République[5], anciens ministres ou commissaires européens[6], parlementaires[7], ou plus simplement membres de conseils généraux ou municipaux, adjoints au maire, fonctionnaires de préfecture, ou même, agents de la sécurité sociale, de France Télécom ou d’EDF[8].
En pratique les condamnations les plus nombreuses concernent les élus locaux, ce qui pourrait s’expliquer par le fait que les nouveaux élus « essaient, en fouillant dans la gestion de leurs prédécesseurs, de découvrir des actes d’ingérence qui leur permettront, la justice pénale aidant, d’écraser plus complètement leurs adversaires politiques »[9].
I. La corruption : un avantage indu pour obtenir un service
La corruption est un délit de pouvoir qui vise le fait, pour une personne investie de certaines fonctions, de solliciter ou d’accepter, sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, un don, une offre, ou une promesse en vue d’accomplir, de retarder, ou d’omettre d’accomplir un acte entrant dans le cadre de ses fonctions, étant précisé que l’incrimination vise aussi bien le secteur public que privé[10].
La loi distingue deux types de corruption qui sont, en réalité, les deux facettes d’une même infraction :
- Le délit de corruption active, qui vise les agissements par lesquels un tiers obtient un avantage d’une personne exerçant une responsabilité publique (ou privée). Est ainsi considéré comme corrupteur actif le chef d’entreprise qui, pour obtenir un marché public, rémunère les membres du conseil municipal. Ce délit vise le corrupteur.
- Le délit de corruption passive, qui traduit le fait, pour une personne publique, de trafiquer sa fonction, en sollicitant ou en acceptant un don ou une promesse. Ce délit vise le corrompu.
Le pacte frauduleux entre celui qui sollicite et celui qui accepte peut être conclu « à tout moment », ce qui signifie qu’il peut être postérieur à l’octroi de l’avantage, par exemple si un responsable politique cherche une récompense pour le service rendu sans droit.
Le délit de corruption étant une infraction formelle, le résultat lui est indifférent : il n’est pas nécessaire, pour que l’infraction soit constituée, que la contrepartie promise ait été effectivement accordée, tant que l’objectif poursuivi par l’offre était proposé de mauvaise foi (« sans droit ») et en vue de l’accomplissement ou l’omission d’un acte entrant dans les fonctions du corrompu.
Qu’elle soit active ou passive, la corruption est sévèrement réprimée : jusqu’à dix ans d’emprisonnement (le maximum pour un délit) et un million d’euros d’amende, ainsi que, comme pour toutes les atteintes à la probité, des peines complémentaires dont l’inéligibilité[11].
II. Le trafic d’influence : un avantage indu pour obtenir une influence
Délit voisin de la corruption, dont il partage largement le texte d’incrimination, le trafic d’influence vise, lui aussi, deux comportements distincts, selon que l’on se place du côté de l’agent public malhonnête, ou de celui qui souhaite bénéficier de l’influence de ce dernier.
Pour un agent public, l’incrimination vise le fait d’avoir, sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, sollicité ou agrée des offres, promesses, dons ou avantages quelconques pour lui-même ou pour autrui, pour abuser ou avoir abusé de son influence réelle ou supposée en vue de faire obtenir d’une autorité ou d’une administration publique des distinctions, des emplois, des marchés, ou toute autre décision favorable (trafic d’influence passif)[12].
S’agissant du bénéficiaire de l’influence, le texte sanctionne quiconque qui aurait, sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, proposé un avantage quelconque à un agent public pour que celui-ci abuse ou parce qu’il aurait abusé de son influence réelle ou supposée en vue de faire obtenir d’une administration publique des distinctions, des emplois, des marchés, ou toute autre décision favorable (trafic d’influence actif)[13].
Là aussi, les deux auteurs doivent avoir agi de mauvaise foi et pour abuser ou avoir abusé d’une influence réelle ou supposée ; le bénéfice réel de l’opération étant, là encore, indifférent à la caractérisation du délit.
Qu’il soit actif ou passif, le trafic d’influence est puni des mêmes peines que la corruption.
III. La prise illégale d’intérêts : la persistance d’un conflit d’intérêts
Parce qu’elles sont censées servir la chose publique d’un cœur sans partage, les personnes publiques ne doivent pas être en situation de privilégier leurs intérêts aux dépens des intérêts dont elles ont la charge.
Le délit de prise illégale d’intérêts, ou délit d’ingérence, consiste donc, pour une personne publique, dans le fait « de prendre, recevoir ou conserver, directement ou indirectement, un intérêt de nature à compromettre son impartialité, son indépendance ou son objectivité dans une entreprise ou dans une opération dont elle a, au moment de l’acte, en tout ou partie, la charge d’assurer la surveillance, l’administration, la liquidation ou le paiement »[14].
Ce délit-obstacle vise donc à empêcher qu’une situation de conflit d’intérêts apparaisse ou perdure, indépendamment des intentions réelles de l’agent, afin d’éviter non seulement que celui-ci succombe à la tentation de privilégier ses intérêts propres, mais aussi qu’un doute puisse naître dans l’esprit des administrés sur la droiture de ses actes, quand bien même ils seraient désintéressés.
Les décisions de condamnation sont nombreuses, autant parce que Montesquieu semble avoir raison[15], que parce cette incrimination est une arme redoutable et simple à utiliser par des opposants politiques ou toute personne que l’intérêt général préoccupe sincèrement[16].
Les peines prévues pour ce délit vont jusqu’à cinq ans d’emprisonnement et 500 000 euros d’amende, outre l’inéligibilité et d’autres peines complémentaires.
Les exemples typiques sont le cas d’un maire qui signe des arrêtés de nomination de membres de la famille de son directeur de cabinet[17], ou le président d’une ONG qui confie l’organisation d’actions de formation à une société dont sa femme et son fils sont gérants[18], ou celui du maire d’une commune et de l’un de ses adjoints qui participent aux délibérations et au vote du conseil municipal portant sur une modification du PLU destinée à rendre plus facilement constructible une zone sur laquelle les deux intéressés y détenaient des biens immobiliers[19].
Il est à noter que des exceptions sont prévues pour les personnes exerçant des responsabilités publiques dans les communes de 3 500 habitants au plus, et que ce délit vise également, selon des modalités un peu différentes, les personnes ayant cessé leurs fonctions publiques depuis moins de trois années et qui exerceraient dans le secteur privé (délit de pantouflage)[20].
Le favoritisme : un avantage indu envers un candidat à un marché public
Le délit de favoritisme sanctionne le fait de procurer ou tenter de procurer à autrui un avantage injustifié par un acte contraire aux dispositions législatives et réglementaires ayant pour objet de garantir la liberté d’accès et l’égalité des candidats dans les marchés publics et les contrats de concession[21].
Pour ce délit, la loi prévoit un spectre plus large d’auteurs potentiels, englobant toute personne, quel que soit son statut, qui interviendrait dans le processus d’attribution d’un marché public, sans qu’il soit déterminant qu’elle dispose effectivement d’un pouvoir de décision ou non.
L’objectif de cette incrimination est de trouver le juste équilibre entre différentes considérations : la liberté du commerce et de la commande publique, la compétitivité, mais aussi la transparence, l’égalité et la moralisation de la vie économique.
Pour simplifier, l’infraction consiste dans le fait de violer une règle encadrant les marchés publics et les contrats de concession interdisant les pratiques discriminatoires (donc garantissant la liberté d’accès et l’égalité des candidats), pour avantager ou tenter d’avantager indûment un candidat au marché.
Le bénéficiaire de l’avantage litigieux doit être un tiers, l’avantage consenti à soi-même n’entrant pas dans la qualification de favoritisme, mais de prise illégale d’intérêts.
Ici encore, il n’est pas requis, pour que l’infraction soit consommée, que l’avantage litigieux ait été obtenu dès lors qu’est caractérisée l’intention frauduleuse, assez facilement déduite des circonstances ou de la personnalité du prévenu.
Les peines peuvent aller jusqu’à deux ans d’emprisonnement et 200 000 euros d’amende, ce montant pouvant être porté au double du produit tiré de l’infraction, outre l’inéligibilité.
Les qualifications de favoritisme et de corruption passive peuvent se cumuler et être appliquées aux mêmes faits reprochés à la même personne, dès lors qu’il s’agit de délits distincts protégeant des intérêts différents et que le principe de non-cumul des peines de même nature est respecté[22].
Une difficulté collatérale peut surgir à l’occasion de poursuites pour l’une des infractions ci-dessus : la médiatisation.
Favorisée par la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme qui protège intensément la liberté d’expression[23], la médiatisation des « affaires » est devenue presque inévitable sous la poussée d’une opinion publique réclamant toujours plus de transparence dans la vie publique et « le droit de (tout) savoir ».
Tribut payé à l’exigence de moralisation de la vie publique, ce phénomène transforme les médias, y compris bien-sûr les réseaux sociaux, en une forme habituelle de tribunal populaire « hors les murs »[24], parfois sans foi ni loi, susceptible d’entraîner des effets dévastateurs : diffamations, injures, atteintes à la vie privée, dénonciations calomnieuses, instrumentalisation politique, sans oublier l’effet de lynchage souvent démesuré permis par les réseaux sociaux.
De ces excès il faut aussi savoir se défendre, hors et dans les tribunaux : les atteintes à la probité, réelles ou supposées, ne sont jamais une raison pour faire preuve d’immoralité.
Avocat chargé du pôle pénal
[1] Comme le formule Montesquieu : « C’est une expérience éternelle que tout homme qui a du pouvoir est porté à en abuser. » (MONTESQUIEU, De l’esprit des lois, 1748)
[2] Par exemple, une ordonnance de Saint Louis de 1254 et une autre de Charles VI de 1388 interdisaient aux gouverneurs d’accomplir, dans leur province, un grand nombre d’actes susceptibles d’entraîner des abus de pouvoir, notamment emprunter, acquérir, marier leurs enfants avec des habitants de ces territoires (Daniel JOUSSE, Traité de la justice criminelle, 1771).
[3] Ibid. note 1
[4] Raison pour laquelle ces infractions sont regroupées au sein du livre IV du code pénal intitulé « Des crimes et délits contre la nation, l’Etat et la paix publique ».
[5] Jacques Chirac, Nicolas Sarkozy (celui-ci étant encore, à ce jour, présumé innocent dans l’attente d’une décision définitive)
[6] Alain Juppé, Edith Cresson
[7] Comment ne pas évoquer la grande affaire qui a précipité l’avènement de lois anticorruption : le scandale de Panama, jugé par la cour d’appel de Paris en 1893, mettant en cause plus de cent parlementaires qui auraient touché d’importantes sommes d’argent, et qui se conclut notamment par la condamnation à cinq ans de prison de l’ancien ministre des Travaux publics, Charles Baïhaut.
[8] Crim. 21 janv. 1959, Bull. crim. N°59, Crim. 30 juin 2010, n°09-83.689, Crim. 29 juin 2011, n°10-86.771
[9] Y. MULLER-LAGARDE, Prise illégale d’intérêts, J.-Cl. Pénal, fasc. 20
[10] Pour le secteur public : art. 432-11, 1° (corruption passive) et 433-1, 1° (corruption active) du code pénal ; pour le secteur privé : art. 445-1 et s. du code pénal
[11] Art. 432-17 du code pénal
[12] Art. 432-11, 2° du code pénal
[13] Art. 433-1, 2° du code pénal
[14] Article 432-12 du code pénal
[15] Cf. note 1.
[16] On peut penser notamment à l’association ANTICOR.
[17] Crim., 11 mars 2014, n°12-88.312
[18] Crim., 3 avril 2007, n°06-83.801
[19] Crim., 3 avril 2019, n°18-83.599
[20] Art. 432-13 du code pénal
[21] Article 432-14 du code pénal
[22] Crim., 12 juillet 2016, n° 15-80.477
[23] Article 10 de la Convention européenne des droits d’homme
[24] S. GUINCHARD, Les procès hors les murs, in J. BEAUCHARD et P. COUVRAT (dir.), Droit civil, procédure, linguistique juridique. Ecrits en hommage à Gérard Cornu, PUF, 1994









